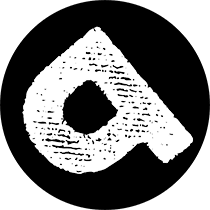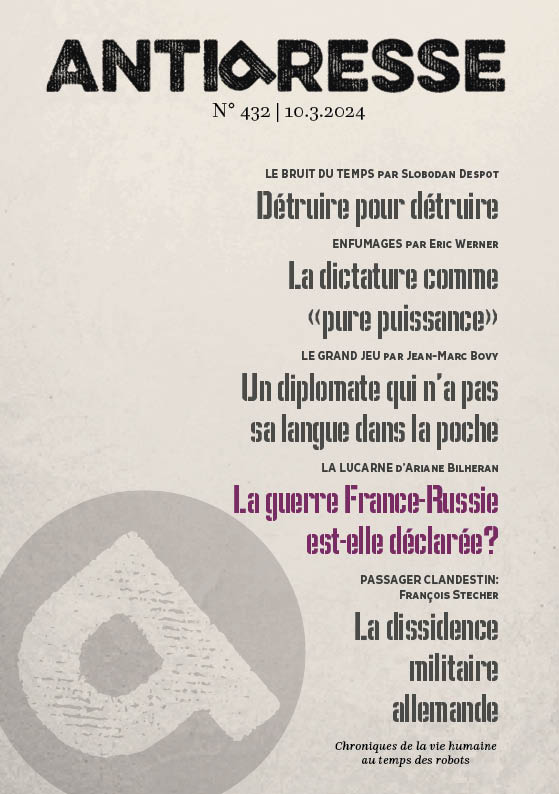Les cahiers de doléances français seront bientôt dépouillés et savamment interprétés. Cette restauration d’une coutume d’Ancien Régime n’est certainement pas pour déplaire au locataire élyséen, au point qu’il pourrait en oublier les douleurs signifiées. Le président qui se plaisait récemment à rappeler que sa police n’avait encore endeuillé aucun «complice du pire», les aurait sans doute privés de toutes condoléances, tant le tourment des éborgnés du samedi le révèle indolent. Il est vrai que «le cœur ne veut doulloir ce que l’œil ne peut voir» comme disait sire Oudin (1611). Mais il ne faut jamais dédaigner l’affliction populaire, sauf à lui mijoter ce «pire». Le latin dolere, d’où proviennent doléance, douleur, deuil, etc. plonge en effet ses propres racines dans l’indo-européen commun delh1* qui signifie «diviser, sectionner, dépecer». C’est dire quel supplice un tel vocable invoque. La seconde racine indo-européenne probable dū̆- n’est pas moins terrifiante, puisqu’elle porte le sens de «destruction […]
L’union du trône et de l’autel
Projetons-nous un demi-siècle en arrière: l’Église officielle aurait-elle osé alors défendre l’homosexualité et condamner sa criminalisation? Non, bien sûr. Ce n’était pas dans l’air du temps ni prescrit par l’État. Or les Églises officielles sont très sensibles à l’air du temps. Ainsi qu’aux prescriptions de l’État…