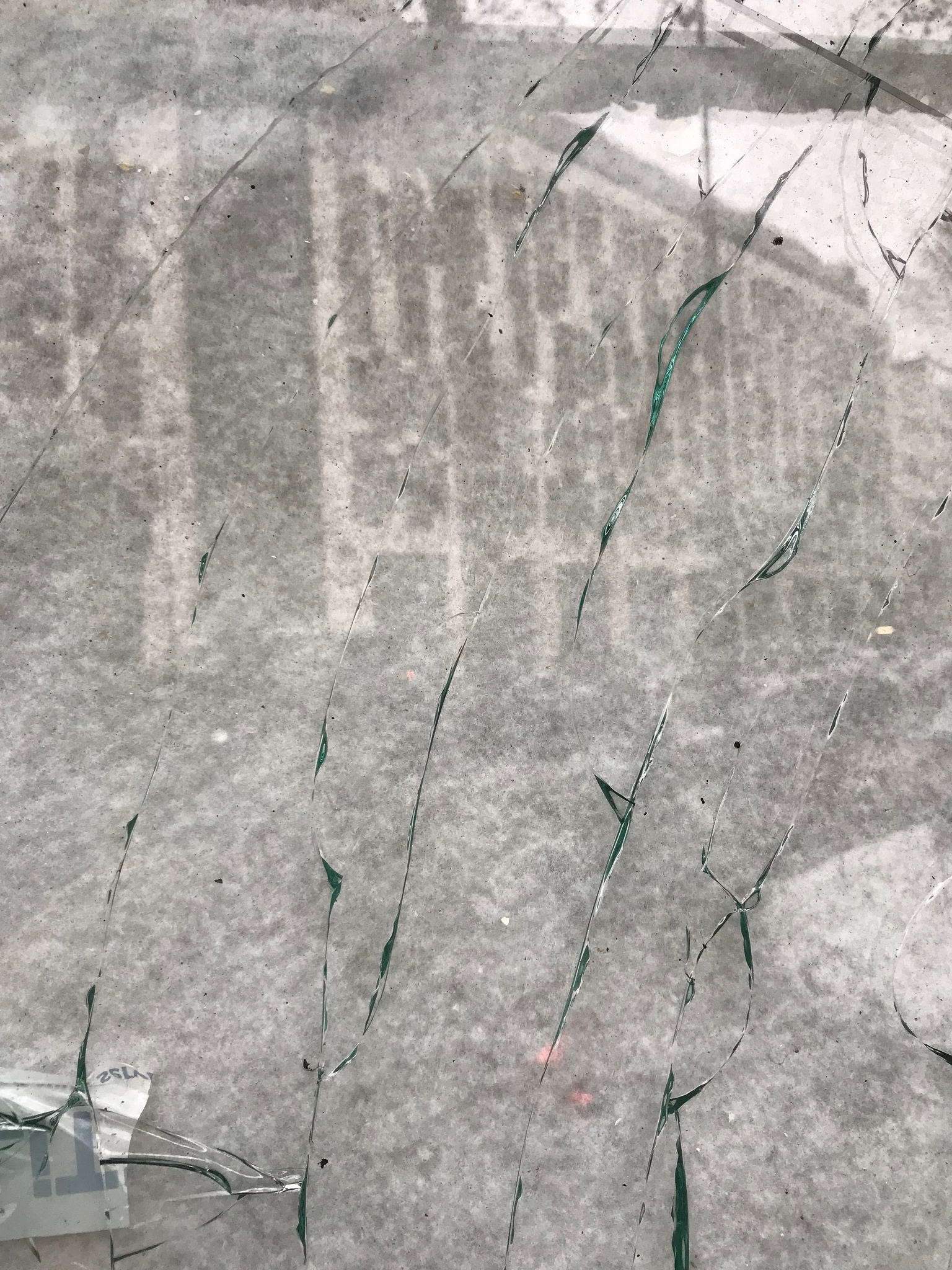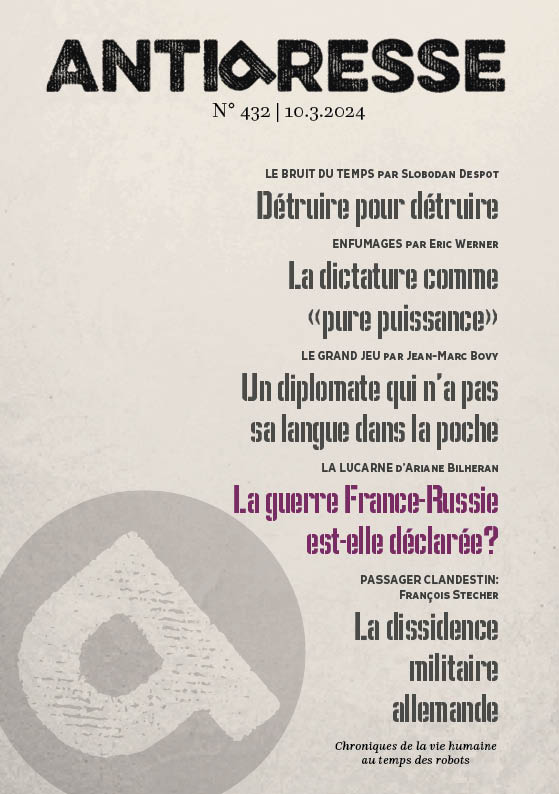Les Gaulois, décidément, ne font rien comme les autres. Le printemps de la France, ils ont réussi à le coller en décembre. Je ne sais sur quoi il débouchera, je sais seulement que dans ce pays, l’on se sent moins seul. Voici donc en vrac quelques tableaux d’une révolution nationale qui n’ose pas encore afficher son nom.
«I was a free man in Paris,
I felt unfettered and alive
There was nobody calling me up for favors
And no one’s future to decide… » (Joni Mitchell)
En liberté dans Paris
Presque malgré moi, j’ai passé mon temps à humer l’air parisien en cette semaine de veillée d’armes. Mardi, j’avais manqué mon train du retour vers la Suisse. Plutôt que de prendre le suivant, j’ai étiré le séjour jusqu’au dernier moment possible, au vendredi. Il m’est arrivé trop souvent de manquer des événements historiques pour des futilités. Cette fois-ci, quelque chose me disait de rester là et d’écouter sans rien attendre.
Étrange position ! A certains moments, j’étais un étranger libre et curieux, un diplomate persan écrivant ses lettres ironiques pour des lecteurs lointains. A d’autres, j’éprouvais des frémissements d’entrailles comme si c’était mon propre pays qui secouait ses chaînes. Je l’ai dit mille fois, mais il faut bien le rappeler ici : je suis Serbe de naissance, Suisse d’adoption, mais Français d’expression. Pour un écrivain, c’est souvent la composante la plus déterminante de son identité. Les choses que je peux écrire en français, je ne peux les exprimer dans ma langue maternelle sans de laborieuses périphrases. Et la manière peu accentuée dont je le parle me rend suspect dans le terreau helvétique. Bref, je ne me suis jamais senti aussi français sans passeport que ces derniers jours.
Pourquoi ces derniers jours ? Parce que j’ai senti la France se réveiller en ravivant sa vieille religion des barricades. Or les révolutions françaises ne sont pas que des remises à zéro sociopolitiques. Elles ravivent toutes les questions de fond que cette nation trop sociable aime à enterrer sous les frivolités. Elle-même, très souvent, continue à se boucher les oreilles face à la rumeur qu’elle soulève. C’est pourquoi l’historien le plus lucide de la Révolution française fut un Écossais, Thomas Carlyle. Et son romancier le plus mémorable ? Le Dickens de A Tale of Two Cities, ce va-et-vient Paris-Londres où l’on saisit de tout son être le gouffre de mentalité et de destin qui sépare ces deux peuples si voisins.
La fin de l’hypernormalisation
Voici donc, enfin, que quelque chose se passe. Voulez-vous dire (me répondra-t-on) qu’il ne s’est rien passé après Charlie et le Bataclan ? Que la Manif pour tous ne fut qu’une promenade digestive ? Eh bien… oui. C’est ce que je veux dire. Charlie, Bataclan et même la Manif pour tous furent des mouvements immobiles qui n’ont pas déplacé d’un centimètre l’axe de l’hologramme servant de réalité sédative pour la population française. Indignez-vous ! ordonnait le gérontoidéaliste Stéphane Hessel. On l’a acheté à des millions d’exemplaires. On s’est indigné de toute la noire misère du monde. Et l’on est retourné à ses occupations en enjambant les gueux qui encombraient nos portes cochères.
Car l’indignation est un sport de ventres pleins, et les gouvernants le savent. Ils adorent entretenir l’indignation, cette eau toujours frémissante qui n’atteint jamais son point d’ébullition — idéale, donc, pour faire du thé. Car il est rare que le malheur des autres nous fasse bouillir. L’ébullition survient quand notre propre peau est en jeu. Or les gilets jaunes qui font trembler « l’ordre républicain » devenu synonyme d’oligarchie sont justement l’uniforme des ventres vides.
Quand l’indignation fait place à la colère, un ordre fondé sur la moralisation culpabilisante perd d’un seul coup toutes ses armes… sauf les vraies, celles qui tuent.
C’est pourquoi la France des semaines de veillée d’armes succède à des décennies de paix factice, cette troisième mi-temps des régimes effondrés que, dans l’URSS des années 1970, on a appelée l’hypernormalisation. Comme toute illusion, l’hypernormalisation française nécessitait d’une part l’artifice, de l’autre la connivence du public. Or soudain, en quelques jours, le montage s’est effondré comme dans l’URSS de 1989. L’inutilité soudain révélée au grand jour de la caste des bavards parisiens — et plus encore leur hystérie panique — est la meilleure preuve que l’illusion se déchire. Qu’on arrive dans le vif du sujet. Lorsque j’ai vu le plus placide des porte-parole du Système, Jean-Michel Aphatie, s’affoler (avec son faux-bonasse accent du Midi) sur la mollesse des CRS face à la foule et crier « mais que fait la police ? », j’ai acquis la certitude qu’on ne plaisantait plus. La gauche d’idées devenue la gauche de bien être ne jure plus que par la force publique.

Le bestiaire de Faustine
Le mot n’est pas de moi. « Il ne reste plus rien de la gauche intellectuelle dans ce pays, qu’une gauche de bien-être », m’avait dit mon amie Faustine, rédactrice dans un journal de grand chemin français. « Leur seul souci ? Savoir que leurs petites habitudes et leurs grands privilèges seront préservés. Le moyen n’importe pas. » A la cafétéria de la rédaction, elle ne pourrait pas prononcer le début de cette phrase. De toute façon, on la soupçonne de dissidence, elle ne sait même pas pourquoi : ses goûts littéraires ? Ses fréquentations ? Sa marque de maroquinerie ? Du coup, avec moi, l’étranger bienveillant, elle se lâche. Combien sont-ils/elles, dans les couloirs des grands médias et des administrations d’État, qui aimeraient se trouver un confident d’outre-frontière qui publierait leurs doléances sans révéler leurs noms ?
Faustine a sympathisé d’emblée avec les gilets jaunes. Elle s’est mêlée samedi dernier à la manif, entourée de quelques copines. Et les hommes du journal ? Des journalistes qui n’ont pas voulu assister à l’histoire qui se fait sous leurs yeux ?
« L’un avait un concert, l’autre devait aller chercher ses enfants… Bref, ils ont la trouille. Les types en veste de baroudeur, ça pleure jamais. Donc ça évite les lacrymogènes. »
Il n’y a pas d’hommes à proprement parler dans le milieu de Faustine. Son bestiaire quotidien est composé d’onagres et d’hermaphrodites. « Crevettes » lettreuses : hanches étroites, lunettes rondes, fuseaux trop courts sur chaussettes fuchsia. « Loufiats » du business au regard blasé et hautain de la haute domesticité : « les Nestors de l’hyperclasse ». Cette caste servile et qui se croit régnante d’où est issu le Président lui-même. Tout ce petit monde est nerveux et sue la trouille. Dans un ultime et imprudent réflexe d’impunité, ils continuent d’insulter le peuple en se cachant derrière les forces de l’ordre.
« Le soulagement que c’était de voir des bonnes bouilles de provinciaux à l’Alma ! Des gens ordinaires, rieurs, roses de froid. Face à ces masques de cendre renfrognés, les Parisiens… » Au coin d’une rue, elle a vu passer Alain Minc, minuscule. Un furet en exploration au crépuscule du soir. Pour prendre la température ? Décider s’il fallait préparer les bases arrière outre-Atlantique ?
La sociabilité des ronds-points
« Les Français sont les plus gros consommateurs de tranquillisants au monde, me dit Faustine. Je nous croyais tous sous neuroleptiques. Je pensais la classe ouvrière euthanasiée. »
Et la voilà qui ressort, comme une armée des ombres. Sauf que cette classe ouvrière 2.0 dont me parle Faustine comporte des médecins, des entrepreneurs… et même un châtelain normand de mes connaissances. Sous le gilet jaune, la France « qui pue la clope et le diesel » est blanche, noire et arabe, homme et femme, riche et pauvre… quoique rarement parisienne. Elle réalise concrètement ce concept du « vivre ensemble » que le système s’est désespérément efforcé d’imposer à coups de lavage de cerveau.
« Dans les zones commerciales où il ne subsiste plus un seul bistrot, le rond-point est devenu le lieu de la sociabilité. On a tout le temps. On apporte des petits gâteaux, on se verse du café et l’on en donne aux passants. » Et la parole se libère soudain. Et l’on découvre en écoutant que ce « populo » est moins idiot qu’on ne le dépeint dans les bandes dessinées. Que son inarticulation et sa maladresse elles-mêmes lui ont été imposées d’en haut, comme un tatouage de serfs.
Tout ce potentiel d’expression comprimé comme un ressort, je l’avais perçu dès 2014, lorsque mon roman Le Miel m’avait emmené en un tour de France des bibliothèques et des librairies. Dans les provinces les plus reculées, j’ai rencontré des cercles de lecture pétillants de culture et de curiosité (j’en ai du reste parlé ailleurs). A une écrasante majorité, ils étaient composés d’hommes — et surtout de femmes — de cette classe moyenne dévalisée qui se réveille aujourd’hui.
Le « mal fini »
Je m’attendais à évoquer en quelques lignes les actes du pouvoir, l’abandon délibéré des belles avenues à la racaille, les provocations, l’ineptie du président de synthèse. Cela ne me semble plus d’intérêt. Le protégé de Brigitte, je l’ai orthographié Macron® comme un produit industriel dès avant son élection et j’ai relevé son inquiétant manque d’intelligence au moment même où l’on nous matraquait avec sa brillance et sa maîtrise. La haine personnelle contre ce personnage immature et arrogant est le ciment même de cette vague jaune si décentrée et d’autant plus dangereuse. « Il n’est pas fini »: le mot d’un officier humilié m’est revenu aux oreilles à plusieurs reprises ces derniers ours. Mais il n’y a pas que lui. En quelques jours seulement, la classe politique française dans son ensemble est devenue du passé, en particulier les calamiteux députés de cette « République en marche » rassemblée de bric et de broc au lendemain de la présidentielle. Quant à la classe médiatique, en particulier du côté des porte-voix de milliardaires comme BFMTV, elle a perdu le peu de crédibilité qu’il lui restait.
« Si quelqu’un n’avait pas encore compris que Macron était le produit d’un coup d’État médiatico-financier, il n’a plus d’excuse maintenant », conclut Faustine. Étant le produit d’une conjuration, il entraîne dans sa chute tout le cercle des conjurés.
Furia francese
Dans mon train du retour, ce vendredi, alors que je rassemblais justement mes notes, un agent des douanes françaises me reconnaît. Il hésite un peu, laisse son collègue poursuivre les contrôles et entame la conversation. La quarantaine juvénile, il est vif et bien renseigné. Choqué par le dénigrement systématique de la Russie en France, il a lu avec soulagement mon « Syndrome Tolstoïevsky ». De fil en aiguille, le douanier en uniforme et l’écrivain finissent par prendre un café au bar. C’est la semaine de la convivialité dans toute la France, pourquoi pas dans le TGV ? Je ne me serais jamais attendu à ce qu’un agent en uniforme me parle de l’Idiot de Dostoïevski. Au bout de quelques minutes, nous sommes rejoints par un passager qui avait entendu (malgré lui !) le début de notre conversation à propos de géopolitique.
Jean-Claude est homme de spectacle, engagé à l’UPR chez Asselineau, l’homme qu’il ne faut surtout pas laisser parler (parce qu’on ne sait quoi lui répondre). Il est doux et raisonnable comme la plupart des gens que j’ai rencontrés dans cette mouvance. On parle d’histoire, de désinformation, des guerres coloniales auxquelles la France a été mêlée ces dernières années, toujours dans le mauvais camp et sans jamais avoir été consultée. « On se sent soudain moins seul », me dit-il.
« Pourquoi ?
— Parce que ce que je comprenais était si loin des idées admises que j’ai fini par me croire marginal ou stupide. Je suis rassuré de voir que nous sommes au moins quatre. »
Quatre avec le douanier, l’écrivain et le chef de train, qui s’était joint au cénacle. Quatre millions, peut-être, avec tous ces Français qui se découvrent éveillés et lucides au forum des ronds-points. « Les mots ne trompent pas, conclut Hervé le douanier. Tout ce peuple est en révolte, et les télés appellent cela de la grogne. C’est le bétail qui grogne. Les humains, eux, ils parlent. Mais, manifestement, il y a des gens dans ce pays qui n’arrivent pas encore à l’admettre. »
La « grogne » contre la nouvelle dîme masquait bel et bien une rébellion populaire contre toute une caste dont le malheureux Macron n’est que le représentant le plus caricatural et le bouc émissaire.
- Article de Slobodan Despot paru dans la rubrique «Le Bruit du Temps» de l’Antipresse n° 158 du 09/12/2018.