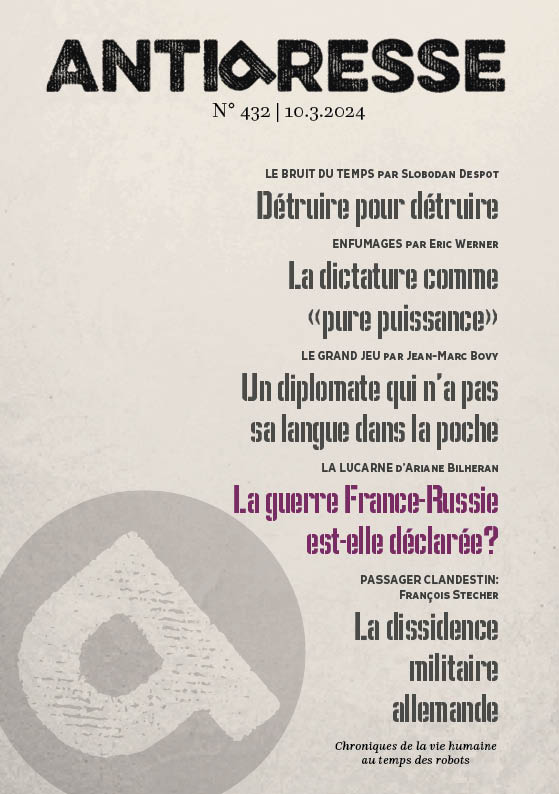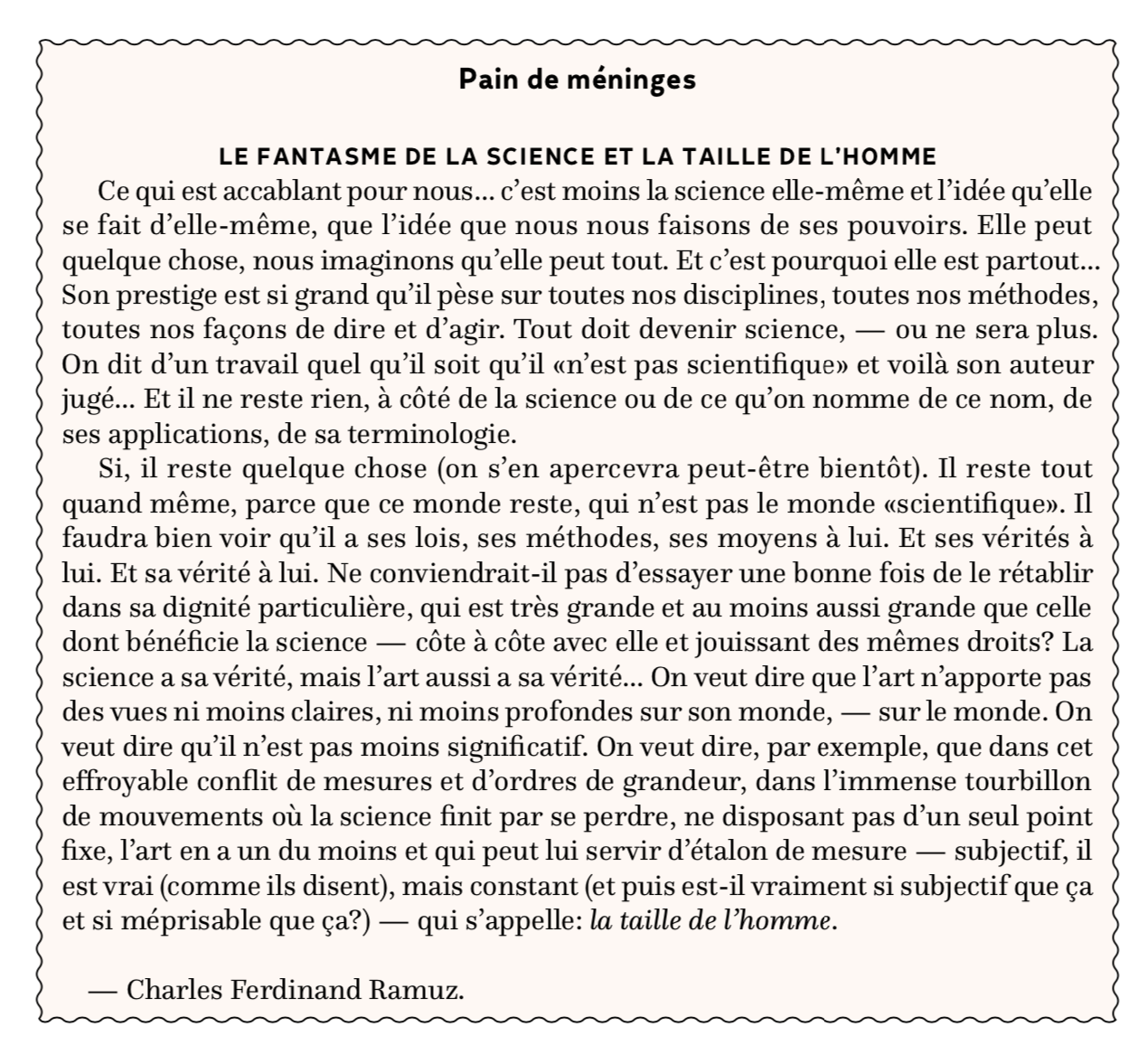
Ce qui est accablant pour nous… c’est moins la science elle-même et l’idée qu’elle se fait d’elle-même, que l’idée que nous nous faisons de ses pouvoirs. Elle peut quelque chose, nous imaginons qu’elle peut tout. Et c’est pourquoi elle est partout… Son prestige est si grand qu’il pèse sur toutes nos disciplines, toutes nos méthodes, toutes nos façons de dire et d’agir. Tout doit devenir science, — ou ne sera plus. On dit d’un travail quel qu’il soit qu’il «n’est pas scientifique» et voilà son auteur jugé… Et il ne reste rien, à côté de la science ou de ce qu’on nomme de ce nom, de ses applications, de sa terminologie.
Si, il reste quelque chose (on s’en apercevra peut-être bientôt). Il reste tout quand même, parce que ce monde reste, qui n’est pas le monde «scientifique». Il faudra bien voir qu’il a ses lois, ses méthodes, ses moyens à lui. Et ses vérités à lui. Et sa vérité à lui. Ne conviendrait-il pas d’essayer une bonne fois de le rétablir dans sa dignité particulière, qui est très grande et au moins aussi grande que celle dont bénéficie la science — côte à côte avec elle et jouissant des mêmes droits? La science a sa vérité, mais l’art aussi a sa vérité… On veut dire que l’art n’apporte pas des vues ni moins claires, ni moins profondes sur son monde, — sur le monde. On veut dire qu’il n’est pas moins significatif. On veut dire, par exemple, que dans cet effroyable conflit de mesures et d’ordres de grandeur, dans l’immense tourbillon de mouvements où la science finit par se perdre, ne disposant pas d’un seul point fixe, l’art en a un du moins et qui peut lui servir d’étalon de mesure — subjectif, il est vrai (comme ils disent), mais constant (et puis est-il vraiment si subjectif que ça et si méprisable que ça?) — qui s’appelle: la taille de l’homme.
— Charles Ferdinand Ramuz.