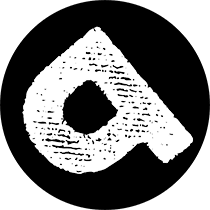Pain de méninges
Du dépouillement oriental
«Il y a chez l’Hindou une propension à se dépouiller qui lui est aussi naturelle que de s’asseoir. Tout le monde, à de certains moments décisifs, se réveille pour lutter ou conquérir. L’Hindou se réveille pour lâcher tout. Le temps de dire «ouf»: le roi quitte son trône, le riche se dépouille de ses habits, abandonne son palais, le fondé de pouvoirs de la Chartered Bank of India, sa position. Et non pas au profit de quelqu’un (c’est curieux, je ne trouve jamais l’Hindou bon, il ne s’occupe pas des autres, mais de son salut). Mais c’est comme si son vêtement ou l’appareil de sa richesse lui faisait mal à la peau…» — Henri Michaux, Un barbare en Asie, éd. Gallimard.
De la solitude moderne
La majorité des jeunes femmes, des jeunes hommes d’aujourd’hui vivra seule. Faut-il les plaindre, s’en inquiéter ou s’en réjouir? Il n’y a pas de quoi, vraiment. Pour le meilleur ou pour le pire, la société moderne fabrique de l’isolement, c’est même le produit social le plus remarquable des trente dernières années, derrière le trompe-l’œil des socialismes et des revendications urbaines. Les sociétés traditionnelles fabriquaient des couples, des familles, des enfants, des liens, aussi bien que des inégalités. Et elles fabriquaient du vivre-ensemble. Le socialisme libéral produit du vivre-côte-à-côte. — Hervé Juvin, Le gouvernement du désir, Gallimard, 2016.
Les fleurs et les morts
Il me faut encore mentionner ceci: les fleurs ont un rapport avec les morts. C’est pourquoi il est nécessaire que les cimetières soient des jardins. Toutes les fleurs sont en lien avec la mort, mais par-dessus tout les fleurs cueillies, les tresses et les couronnes. Comme c’est étrange, n’est-ce pas? Les tresses vont aux jeunes mariées et aux défunts. Qu’est-ce qui meurt vraiment dans un mariage et en quoi la mort est-elle semblable à une fête? Schuler dit que la fleur est un symbole de l’existence ouverte. Existence ouverte? Qu’est-ce donc? Une existence qui s’étend par-delà les bornes visibles de la vie. Qui s’étend en premier lieu à l’existence d’avant et d’après la vie, d’avant la naissance et d’après la mort. C’est une existence que la vie ne délimite pas, qui est ouverte vers l’avant comme vers l’arrière, vers le haut comme vers le bas. Ceci est évidemment réservé aux […]
De l’esprit révolutionnaire
«L’avocat et le littérateur sont (…) les porte-parole du tiers état et de son émancipation, les porte-parole des lumières, de la raison, du progrès, de la philosophie, contre les seigneurs, l’autorité, la tradition, l’histoire, le «pouvoir», la monarchie et l’Eglise — les porte-parole de l’Esprit qu’ils considèrent comme le seul unique et éblouissant, l’esprit vrai, l’esprit même, l’esprit en soi, alors qu’ils ne connaissent et n’entendent que l’esprit politique de la révolution bourgeoise.» Thomas Mann, Considérations d’un apolitique, Grasset, p. 51.
Le bourgeois a-t-il besoin de penser?
«Le vrai Bourgeois, c’est-à-dire, dans un sens moderne et aussi général que possible, l’homme qui ne fait aucun usage de la faculté de penser et qui vit ou paraît vivre sans avoir été sollicité, un seul jour, par le besoin de comprendre quoi que ce soit, l’authentique et indiscutable Bourgeois est nécessairement borné dans son langage à un très petit nombre de formules. Le répertoire des locutions patrimoniales qui lui suffisent est extrêmement exigu et ne va guère au delà de quelques centaines. Ah! si on était assez béni pour lui ravir cet humble trésor, un paradisiaque silence tomberait aussitôt sur notre globe consolé!» Léon Bloy, Exégèse des lieux communs.
Une épée de lumière
«Parfois, au cœur même de la vie active, je sens brusquement que tout s’en va, que les choses quittent le monde, que les hommes se quittent les uns les autres. Alors je retourne à ma solitude, la vraie patrie de ma conscience. Ma solitude, ce n’est pas le silence et l’immobilité de la nuit aveugle, c’est le sanglot et le cri de joie de tous les destins humains et de toutes les exigences de la vie, depuis les débuts du monde jusqu’à aujourd’hui. C’est la rotation tourbillonnante d’innombrables soleils en face desquels celui qui nous chauffe n’est qu’un jouet, c’est le bourdonnement d’un million de cloches cosmiques dont les planètes sont les balanciers. Et à travers cet univers sans fin et sans nom est plantée, pareille à une colonne, du sommet jusqu’à la base, une épée de lumière — ma conscience.» — Ivo Andrić, Signes au bord du chemin, éd. […]
Langues premières, langues essentielles
« Les langues ne sont en majorité que des moyens d’expression du “je” individuel. Selon Guénon, l’ère de l’antitradition commence au moment où, à la Renaissance, le latin a fait place à des langues nationales inaptes à énoncer des contenus universels. Le point de vue de la science moderne est évidemment contraire. Son hypothèse est que les peuples archaïques étaient primaires, et de même leurs langues, d’autant plus primaires qu’ils étaient plus anciens. La vérité est justement à l’opposé. Plus une langue est ancienne et plus elle est métaphysique. S’il en allait autrement, nous ne serions pas obligés de puiser chacun de nos termes universels dans le chinois, le sanscrit, le grec ou le latin. » — Béla Hámvas.
L’Amérique de la peur
«La peur et l’insécurité qui règnent actuellement aux Etats-Unis sont le produit de la capillarité du système américain, fruit des débordements individuels autant que de la corruption secrète et de la concussion. Elles font, de la part du pouvoir, l’objet d’enquêtes minutieuses, sans rapport possible de nature avec la montée irrésistible de l’«improvisation criminelle» dans le pays. Car, désormais, les slums et les ghettos dégorgent, la peur civile s’étend à l’ensemble des métropoles, la fuite vers la banlieue devient elle-même inutile. Ce flot est en train de submerger l’Amérique, il la submergera si aucune structure nouvelle ne vient l’endiguer.» — Paul Virilio, «Moralité de la fin», in L’insécurité du territoire, 1976-1991.
Des médias et de leurs antidotes
«C’est un des paradoxes de notre époque: les média n’ont jamais été aussi unanimes ni les moyens de les court-circuiter aussi efficaces.» — Charles-André Aymon, journaliste.